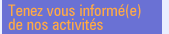Ce qu’il faut retenir du mandat´┐Ż pour la CIG
´┐Żadopt´┐Ż par le Conseil europ´┐Żen le 23 juin 2007
Premi´┐Żre r´┐Żaction sur le document de la pr´┐Żsidence 11177/07 (annexe 1)
´┐Ż
1. Angela Merkel a r´┐Żussi un tour de force.
La crise ouverte par les non fran´┐Żais et n´┐Żerlandais est en principe close. Loin de se contenter de donner une ´┐Ż´┐Żfeuille de route´┐Ż´┐Ż, la Pr´┐Żsidence allemande a obtenu, lors du Conseil europ´┐Żen, un accord ´┐Ż 27 sur la substance. Ainsi, la conf´┐Żrence intergouvernementale (CIG) n’aura plus qu’´┐Ż op´┐Żrer une mise en forme juridique. Ce pari qui n’´┐Żtait pas gagn´┐Ż d’avance a ´┐Żt´┐Ż r´┐Żussi. Naturellement, le soutien de plusieurs Etats membres, dont la France, y a contribu´┐Ż mais le m´┐Żrite en revient largement ´┐Ż la Chanceli´┐Żre qui a su prendre ses responsabilit´┐Żs.
2. La forme est chang´┐Że, la substance reste largement pr´┐Żserv´┐Że.
La principale concession faite au camp du non consiste ´┐Ż renoncer au principe d’une constitution con´┐Żue comme un texte rempla´┐Żant les trait´┐Żs existants´┐Ż; le terme ´┐Ż´┐Żconstitution´┐Ż´┐Ż dispara´┐Żt, comme celui de ´┐Ż´┐Żministre´┐Żdes affaires ´┐Żtrang´┐Żres´┐Ż´┐Ż, ou ceux de ´┐Ż´┐Żlois´┐Ż / lois cadres´┐Ż´┐Ż (au lieu de r´┐Żglements et directives). Sont effac´┐Żes aussi les r´┐Żf´┐Żrences explicites ´┐Ż la devise, ´┐Ż l’hymne ou au drapeau. Notons que ces symboles´┐Żne disparaissent pas pour autant ; ils conservent simplement leur statut actuel. De m´┐Żme, la primaut´┐Ż du droit communautaire express´┐Żment ´┐Żnonc´┐Że dans la constitution ne figurera plus dans les futurs trait´┐Żs mais sa nature jurisprudentielle est rappel´┐Że dans le mandat(1).
En contrepartie, la plus grande part des innovations institutionnelles qui, du reste, n’avaient pas ´┐Żt´┐Ż contest´┐Żes lors des referendums et que 18 pays avaient agr´┐Ż´┐Żes, demeurent acquises´┐Ż; elles sont reprises dans un trait´┐Ż qui modifiera les textes existants, trait´┐Ż UE et trait´┐Ż CE (qui change de nom pour devenir le ´┐Ż´┐Żtrait´┐Ż sur le fonctionnement de l’UE´┐Ż´┐Ż). Une CIG r´┐Żdigera le texte modificatif d’ici fin 2007´┐Ż; il sera soumis ´┐Ż ratification d’ici 2009, essentiellement par voie parlementaire (m´┐Żme G. Brown s’y est engag´┐Ż pour le RU).
L’UE est ainsi´┐Ż revenue ´┐Ż la ´┐Ż´┐Żbonne vieille m´┐Żthode´┐Ż´┐Ż du trait´┐Ż modifiant les trait´┐Żs ant´┐Żrieurs. Pour cette seule raison, il est peu opportun de parler de ´┐Ż´┐Żtrait´┐Ż simplifiÚá╗ puisqu’un acte modificatif est forc´┐Żment plus complexe ´┐Ż lire qu’un texte ob´┐Żissant ´┐Ż sa logique propre comme la constitution. Le mandat qui est publi´┐Ż sur ce m´┐Żme site atteste de la difficult´┐Ż de l’exercice.
3. Les avanc´┐Żes importantes qui´┐Ż sont pr´┐Żserv´┐Żes´┐Ż:
- la personnalit´┐Ż juridique de l’Union´┐Ż
- la charte des droits fondamentaux qui acquiert force contraignante (sauf pour le RU)
- les dispositions de d´┐Żmocratie participative
- les changements institutionnels´┐Żsuivants :
- la cr´┐Żation d’une Pr´┐Żsidence stable du Conseil europ´┐Żen (pour 2 ans et demi)´┐Ż;
- la d´┐Żcision sur la base de la double majorit´┐Ż (m´┐Żme si l’entr´┐Że en vigueur est report´┐Że ´┐Ż 2014 avec possibilit´┐Ż de demander la pond´┐Żration de Nice jusqu’en 2017 + un filet de s´┐Żcurit´┐Ż de type compromis de Ioannina renforc´┐Ż)´┐Ż;
- la cr´┐Żation d’un Haut repr´┐Żsentant pour les affaires ´┐Żtrang´┐Żres, membre de la Commission et du Conseil des ministres (´┐Ż double casquette) et disposant d’un service diplomatique´┐Ż;
- une certaine extension du vote ´┐Ż la majorit´┐Ż qualifi´┐Że, sauf d´┐Żrogation pour les Britanniques sur certains aspects de la justice et les affaires int´┐Żrieures (JAI)´┐Ż;
- les dispositions relatives ´┐Ż la Commission.
4. Quelques (bonnes ou moins bonnes) surprises
- La lutte contre les changements climatiques et la politique ´┐Żnerg´┐Żtique sont mentionn´┐Żes´┐Ż;
- Le nombre d’Etats n´┐Żcessaires pour une coop´┐Żration renforc´┐Że est d´┐Żsormais de 9´┐Ż; les coop´┐Żrations renforc´┐Żes sont facilit´┐Żes en mati´┐Żre de JAI´┐Ż;
- Les crit´┐Żres pour l’´┐Żlargissement (notamment ceux de Copenhague adopt´┐Żs en juin 1993), sont introduits indirectement dans le droit primaire (nouvel article 49)´┐Ż;
- La possibilit´┐Ż expresse de r´┐Żduire les comp´┐Żtences de l’UE´┐Ż est donn´┐Że aux Etats ;
- Le contr´┐Żle des Parlements nationaux est plus pouss´┐Ż que dans la constitution ;
- La disparition, parmi les objectifs de l’UE de la concurrence ´┐Ż´┐Żlibre et non fauss´┐Że´┐Ż´┐Ż´┐Ż; elle reste toutefois inchang´┐Że sur le fond ;
5. Un mot du contexte
Certaines dispositions refl´┐Żtent bien ce qu’il faut appeler un climat de m´┐Żfiance´┐Żenvers l’UE et la Commission´┐Ż: la politique de concurrence´┐Żqui est pourtant d’un des fleurons des politiques communautaires, n’est plus assum´┐Że ;´┐Ż contr´┐Żle accru des Parlements nationaux (au risque du blocage´┐Ż?) ; subsidiarit´┐Ż ´┐Ż´┐Żm´┐Żfiante´┐Ż´┐Ż.
L’esprit communautaire semble envol´┐Ż dans certaines capitales´┐Ż; les revendications polonaises contre ´┐Ż´┐Żl’h´┐Żg´┐Żmonie´┐Ż´┐Ż allemande ´┐Żtaient d´┐Żplac´┐Żes et pourront rejaillir sur les n´┐Żgociations ult´┐Żrieures (budg´┐Żtaires notamment). La multiplication des d´┐Żrogations en faveur des Britanniques am´┐Żne ´┐Ż s’interroger sur leur d´┐Żsir de participer ´┐Ż l’UE. La plus vieille d´┐Żmocratie parlementaire du monde est otage d’une presse outranci´┐Żre qui l’am´┐Żne ´┐Ż perdre des chances de jouer un r´┐Żle leader en Europe.
Les discussions intergouvernementales ´┐Ż huis clos ne sont gu´┐Żre satisfaisantes´┐Ż; le degr´┐Ż de concurrence ´┐Ż pratiquer dans le march´┐Ż int´┐Żrieur, sa combinaison avec une certaine dose de r´┐Żgulation, m´┐Żritait un d´┐Żbat public o´┐Ż les experts, les acteurs ´┐Żconomiques et sociaux, les citoyens pourraient confronter leurs points de vue en public.
Les d´┐Żrogations sont toutefois accord´┐Żes ´┐Ż des pays non membres de la zone Euro. Avec l’ouverture des coop´┐Żrations renforc´┐Żes, une piste se dessine assez nettement pour contourner les r´┐Żcalcitrants.
(1)Si nous pouvons regretter ces abandons, en raison de leur force symbolique, n’oublions pas que le trait´┐Ż portant constitution restait en droit un trait´┐Ż et que c’est m´┐Żme la raison pour laquelle sa non-ratification par un Etat membre suffisait ´┐Ż emp´┐Żcher son entr´┐Że en vigueur.
´┐Ż
Sylvie Goulard,
Pr´┐Żsidente du ME-F