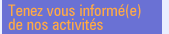LA PRESIDENCE FRANCAISE DE L’UNION
Ces quatre derniers mois, Nicolas Sarkozy a imprim´┐Ż un nouveau rythme ´┐Ż la diplomatie fran´┐Żaise. Ses d´┐Żplacements ´┐Ż l’´┐Żtranger ont ´┐Żt´┐Ż fr´┐Żquents et sa m´┐Żthode originale a ´┐Żt´┐Ż marqu´┐Że par son implication personnelle.
Pour ce qui concerne la politique europ´┐Żenne, on note certes un style volontariste tout ´┐Ż fait nouveau´┐Ż; celle-ci n’en est pas moins frapp´┐Że du sceau de la continuit´┐Ż.
La construction de l’Europe demeure la priorit´┐Ż absolue, mais, Europ´┐Żen de cœur, Nicolas Sarkozy a tenu ´┐Ż sortir les institutions de l’orni´┐Żre dans laquelle elles se trouvaient avec le concours d’Angela Merkel.
Se posent dor´┐Żnavant deux questions´┐Ż:
- L’avenir du projet europ´┐Żen,
- Le cadre de la Pr´┐Żsidence fran´┐Żaise de l’Union.
L’avenir du projet europ´┐Żen s’inscrit ´┐Ż l’int´┐Żrieur de trois dimensions´┐Ż: les missions de l’Europe, le primat de l’Europe de la d´┐Żfense, l’´┐Żradication des crises en Europe et au Moyen-Orient.
L’Europe est sortie du blocage institutionnel qui pr´┐Żvalait depuis dix ans en adoptant le 23 juin 2007 le trait´┐Ż simplifi´┐Ż soumis ´┐Ż une CIG actuellement r´┐Żunie.
D´┐Żs lors, on peut envisager les missions de l’Europe ´┐Ż l’horizon 2020. A ce propos, dans son discours prononc´┐Ż ´┐Ż l’ouverture de la XVe Conf´┐Żrence des Ambassadeurs, le 27 ao´┐Żt 2007, Nicolas Sarkozy sugg´┐Żre la cr´┐Żation d’un comit´┐Ż des sages. Celui-ci devrait avoir une triple fonction´┐Ż: explorer l’avenir des n´┐Żgociations avec la Turquie en faisant en sorte de d´┐Żboucher soit sur l’adh´┐Żsion, soit sur une association aussi ´┐Żtroite que possible, accommodement qui marque un progr´┐Żs dans la r´┐Żflexion du Chef de l’´┐Żtat´┐Ż; parall´┐Żlement , poser le probl´┐Żme des fronti´┐Żres de l’Europe en envisageant l’adh´┐Żsion de tout les pays de l’ex- Yougoslavie et en se demandant quel peut ´┐Żtre le statut d’´┐Żtats tels que la G´┐Żorgie et l’Ukraine´┐Ż; consid´┐Żrer ´┐Żgalement la nature du projet europ´┐Żen´┐Ż: faut-il maintenir une Europe-march´┐Ż ou ne faudrait-il pas avancer jusqu’´┐Ż l’Europe-puissance´┐Ż?
Dans ce dernier cas, il convient, ainsi que Nicolas Sarkozy le pr´┐Żconise, de conf´┐Żrer ´┐Ż l’Europe de la d´┐Żfense un r´┐Żle privil´┐Żgi´┐Ż.
Ceci suppose d’abord qu’une nouvelle strat´┐Żgie de s´┐Żcurit´┐Ż soit ´┐Żlabor´┐Że en 2008 en concertation avec l’Allemagne et le Royaume-Uni.
Ceci suppose ensuite, malgr´┐Ż la conjoncture difficile, l’augmentation des budgets d’´┐Żquipement de la d´┐Żfense de la France et du Royaume-Uni, le doublement des budgets d’´┐Żquipement de la d´┐Żfense de l’Allemagne, de l’Italie, de l’Espagne, de la Pologne des Pays-Bas et du Portugal, ainsi que la multiplication des instruments d’interventions dans les crises, ´┐Ż savoir militaires, humanitaires et financiers, sans omettre l’application du principe des coop´┐Żrations structur´┐Żes.
Ceci suppose enfin que les moyens de l’Europe viennent en compl´┐Żmentarit´┐Ż de ceux de l’Alliance Atlantique, dont 21 pays de l’Union sont membres. Alors, la s´┐Żcurit´┐Ż du monde occidental sera assur´┐Że par le renforcement de l’Europe de la d´┐Żfense et la r´┐Żnovation de l’OTAN.
De cette fa´┐Żon, la France´┐Żet l’Europe pourront participer ´┐Ż l’´┐Żradication des crises en Europe de l’Est et au Moyen-Orient, voire en Afrique.
L’Afghanistan constitue de ce point de vue le mauvais exemple puisque les forces de l’OTAN s’y enlisent face aux Talibans. Le Kosovo constitue au contraire un meilleur exemple dans la mesure o´┐Ż l’Union et l’OTAN, sous mandat de l’ONU, coexistent de fa´┐Żon compl´┐Żmentaire. Cependant, bien que la France souhaite l’ind´┐Żpendance du Kosovo et la cohabitation des Serbes et des Kosovars, l’opposition de la Russie et le manque de r´┐Żalisme des protagonistes sont des facteurs qui peuvent contribuer ´┐Ż un affrontement entre les deux parties.
Dans les 4 crises du Moyen-Orient le jeu de la France est d´┐Żlicat´┐Ż: au Liban, en d´┐Żpit de la pr´┐Żsence du Hezbollah et des sollicitations syriennes, l’influence fran´┐Żaise et le r´┐Żle personnel du Ministre des Affaires ´┐Żtrang´┐Żres favorisent la solution du conflit libanais.
En revanche, dans la strat´┐Żgie de r´┐Żsolution du conflit isra´┐Żlo-palestinien de m´┐Żme que dans l’action de la France en Irak pour y reprendre pied,notre r´┐Żle est peu important.
En ce qui concerne l’Iran, on note une proximit´┐Ż de point de vue de la part des dirigeants des Etats-Unis et de la France, dans la mesure o´┐Ż Nicolas Sarkozy pose le dilemme du maintien du nucl´┐Żaire civil ou du bombardement de l’Iran. Il est de fait que l’acquisition de l’arme nucl´┐Żaire par l’Iran serait un facteur puissant de prolif´┐Żration dans la r´┐Żgion.
Dans ces conflits du Moyen-Orient, le r´┐Żle pr´┐Ż´┐Żminent des Etats-Unis, l’absence de la Politique ext´┐Żrieure de S´┐Żcurit´┐Ż et de D´┐Żfense europ´┐Żenne et le manque d’influence de la France, sauf au Liban, doivent ´┐Żtre pris en compte.
Les pr´┐Żmices de la Pr´┐Żsidence fran´┐Żaise ont ´┐Żt´┐Ż d’abord marqu´┐Żes, comme l’avait promis le Chef de l’Etat, par le retour de la France en Europe ´┐Ż l’occasion du trait´┐Ż simplifi´┐Ż qui a repris la substance du trait´┐Ż constitutionnel.
A dix mois de la Pr´┐Żsidence fran´┐Żaise de l’Union, il faut int´┐Żgrer trois param´┐Żtres incontournables qui sont le retour de l’Europe en France, le r´┐Żle de l’Europe dans la mondialisation, les axes de la pr´┐Żsidence fran´┐Żaise.
Selon Jean-Pierre Jouyet qui intervenait devant la XVe Conf´┐Żrence des Ambassadeurs, le 28 ao´┐Żt 2007, le retour de l’Europe en France implique la reprise des d´┐Żbats avec les Fran´┐Żais sur l’Europe, qui ne per´┐Żoivent correctement que ´┐Ż´┐Żl’importance du couple franco-allemand, partag´┐Że par 80% des Fran´┐Żais´┐Ż´┐Ż.
Il serait bon ´┐Żgalement de revoir la fa´┐Żon de parler de l’Europe, ce qui suppose la conciliation d’un esprit europ´┐Żen et d’une identit´┐Ż nationale forte. L’urgence d´┐Żmocratique consiste en effet ´┐Ż renforcer les dimensions nationales et europ´┐Żennes.
Pour que l’Europe ne soit plus ´┐Ż´┐Żle cheval de Troie de la mondialisation´┐Ż´┐Ż, il est indispensable de r´┐Żfl´┐Żchir ´┐Ż son r´┐Żle dans la mondialisation. On consid´┐Żrera le double effet de la mondialisation, le jeu des responsabilit´┐Żs nationales et la priorit´┐Ż ´┐Ż l’´┐Żchelon europ´┐Żen.
La mondialisation est ´┐Ż la fois ´┐Ż´┐Żlourde d’opportunit´┐Żs et de menaces´┐Ż´┐Ż.
Celle-ci est pour la France et l’Europe une source de croissance et de richesses. Dans le m´┐Żme temps, elle engendre des in´┐Żgalit´┐Żs, s’attaque ´┐Ż des m´┐Żtiers, des personnes et des territoires. On conviendra que, dans notre ´┐Żconomie,´┐Żcertaines choses doivent ´┐Żvoluer et d’autres ´┐Żtre conserv´┐Żes, en allant, peut-´┐Żtre, jusqu’´┐Ż la protection.
Quant ´┐Ż l’exercice des responsabilit´┐Żs nationales, chaque pays doit proc´┐Żder ´┐Ż un travail d’adaptation. Dans les domaines de l’emploi, de la comp´┐Żtitivit´┐Ż, de l’´┐Żducation, de la gestion financi´┐Żre chacun des 27 ´┐Żtats se doit d’accomplir les r´┐Żformes les plus urgentes. C’est dans ce contexte que la r´┐Żunion de l’Eurogroupe de juillet 2007 peut porter ses fruits.
Il reste que la priorit´┐Ż conf´┐Żr´┐Że ´┐Ż l’´┐Żchelon europ´┐Żen demeure d´┐Żterminante pour que les 27 deviennent plus forts dans la mondialisation. Les institutions europ´┐Żennes doivent ´┐Ż la fois ´┐Żtre ouvertes au monde tout en refusant le laisser-faire, d´┐Żfendre nos int´┐Żr´┐Żts sans garder le statu quo, prot´┐Żger ce qui peut l’´┐Żtre tout en conservant la r´┐Żalit´┐Ż d’une concurrence libre et non fauss´┐Że. C’est ´┐Ż travers de nombreux d´┐Żbats politiques que l’on peut appliquer ces principes. On citera, ´┐Ż titre d’exemples, la n´┐Żcessaire r´┐Żnovation de la PAC, la modernisation et la consolidation de notre politique industrielle afin de sauvegarder un avantage comp´┐Żtitif, le maintien des services publics en vue de sauver la coh´┐Żsion de nos soci´┐Żt´┐Żs.
Enfin, les axes de la pr´┐Żsidence fran´┐Żaise de 2008 doivent ´┐Żtre fonction des urgences du moment tout autant que des priorit´┐Żs assign´┐Żes ´┐Ż l’application du programme du Chef de l’´┐Żtat.
De ce point de vue, on peut en d´┐Żgager cinq ´┐Ż l’heure actuelle´┐Ż:
1/ Il s’agit tout d’abord de favoriser la croissance et l’emploi en se r´┐Żf´┐Żrant non seulement ´┐Ż l’agenda de Lisbonne, mais aussi aux priorit´┐Żs de la zone euro.
2/ Il s’agit ensuite de prot´┐Żger les citoyens. Dans le domaine social, une s´┐Żcurit´┐Ż plus forte du parcours professionnel doit accompagner la flexibilit´┐Ż des entreprises. De m´┐Żme, participe ´┐Ż la protection des citoyens une politique d’immigration commune.
3/ Il s’agit ´┐Żgalement d’assurer la traduction l´┐Żgislative des d´┐Żcisions prises en mars 2007 en mati´┐Żre d’´┐Żnergie et de changement climatique, en int´┐Żgrant l’environnement et le d´┐Żveloppement durable. Il s’agit aussi de pr´┐Żparer l’avenir en promouvant Galileo, l’Institut Europ´┐Żen de Technologie ainsi que le d´┐Żveloppement d’Erasmus.
4/ Il s’agit, de la m´┐Żme fa´┐Żon, de maintenir l’influence de l’Europe sur la sc´┐Żne internationale. Dans ce cadre, l’Afrique et son d´┐Żcollage ´┐Żconomique seront trait´┐Żs par Jean-Marie Bockel, tandis que Rama Yade insistera sur le 60eme anniversaire de la d´┐Żclaration des droits de l’homme.
5/ Il s’agit enfin de prendre en compte la mont´┐Że en puissance de l’Union M´┐Żditerran´┐Żenne, dans le contexte du processus de Barcelone et en fondant cette Union sur des solidarit´┐Żs de fait et des projets concrets.
La r´┐Żussite de la Pr´┐Żsidence fran´┐Żaise au 2eme semestre 2008, sera due non seulement ´┐Ż l’accomplissement des projets de l’ex´┐Żcutif – Europe de la d´┐Żfense, environnement, ´┐Żnergie et immigration-, mais aussi ´┐Ż des initiatives fortes dans le domaine culturel ainsi qu’´┐Ż la r´┐Żalisation des projets des citoyens apr´┐Żs qu’ils ont ´┐Żt´┐Ż consult´┐Żs.
´┐Ż
Jean-Fran´┐Żois DURANTIN
Politologue
6 septembre 2007