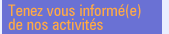QUELLE PRESIDENCE FRANCAISE POUR QUELLE EUROPE´┐Ż?
LE TRAITE SIMPLIFIE, VRAIMENT COMPLIQUE´┐Ż?
Compte rendu du s´┐Żminaire de l'IFRI, 4 octobre 2007
´┐Ż
Philippe Moreau Defarges et Olivier Louis se sont efforc´┐Żs, chacun pour leur part, de pr´┐Żsenter les r´┐Żsultats de la pr´┐Żsidence allemande´┐Ż et du Conseil europ´┐Żen achev´┐Ż le 23 juin dernier. L’expos´┐Ż de Dani´┐Żla Schwarzer a ´┐Żt´┐Ż davantage centr´┐Ż sur le bilan de la pr´┐Żsidence allemande.
D’embl´┐Że, Philippe Moreau Defarges pose les donn´┐Żes du probl´┐Żme´┐Ż: en ce 4 octobre 2007, le projet de trait´┐Ż simplifi´┐Ż est au point, mais est-il cal´┐Ż? En d’autres termes, le Pr´┐Żsident polonais, Lech Kaczynski et son Premier ministre, Jaroslaw Kacynksi, sont toujours susceptibles de remettre en cause la formule de pond´┐Żration des voix dans les d´┐Żcisions du Conseil ´┐Ż la majorit´┐Ż qualifi´┐Że. (double majorit´┐Ż ou racine carr´┐Że de la population de chaque Etat´┐Ż?)
D’autre part l’orateur estime que toute forme de ratification est p´┐Żrilleuse, qu’elle soit de nature r´┐Żf´┐Żrendaire ou parlementaire (en France majorit´┐Ż des 3/5 au Congr´┐Żs). Il pose ensuite la question du syst´┐Żme des institutions europ´┐Żennes´┐Ż qui lui semble ´┐Ż bout de souffle´┐Ż: selon lui, il s’agit d’un syst´┐Żme qui se situe dans les faux-semblants et qui est constitu´┐Ż de strates. Il en tire comme le´┐Żon que l’U.E. est ligot´┐Że´┐Ż: elle ne peut se modifier profond´┐Żment que si les 27 disent oui tous ensemble; les institutions europ´┐Żennes sont plus difficiles ´┐Ż modifier que la charte de l’ONU.
Aux yeux d’Olivier Louis, plusieurs facteurs ont jou´┐Ż pour sauver l’U.E. de la panne institutionnelle´┐Ż: D´┐Żs d´┐Żcembre 2006, Nicolas Sarkozy a propos´┐Ż un ´┐Ż´┐Żmini-traitÚá╗ ou ´┐Ż´┐Żtrait´┐Ż simplifiÚá╗, ´┐Ż Bruxelles, devant un ar´┐Żopage gagn´┐Ż ´┐Ż la cause europ´┐Żenne; de plus, la pr´┐Żsidence allemande s’est activ´┐Że d’abord dans le sens de la conservation du Trait´┐Ż Constitutionnel, ensuite en essayant de d´┐Żgager un consensus sur le trait´┐Ż simplifi´┐Ż, de concert avec Nicolas Sarkozy.
Olivier Louis souligne que, ´┐Ż la diff´┐Żrence du Trait´┐Ż Constitutionnel de 2004, le trait´┐Ż modificatif est compliqu´┐Ż, puisqu’il modifie les trait´┐Żs existants (Rome, Maastricht). Il estime que le Conseil europ´┐Żen du 21 au 23 juin 2007 s’est inscrit entre 2 ´┐Żcueils´┐Ż: d’une part, une tendance ´┐Ż servir ´┐Żla m´┐Żme chose que pr´┐Żc´┐Żdemment´┐Ż´┐Ż´┐Ż; pourtant la m´┐Żthode de travail est moins ´┐Żlabor´┐Że. D’autre part, du fait qu’il s’agit d’un mini-trait´┐Ż; cependant la substance du Trait´┐Ż Constitutionnel (chapitre 1) est conserv´┐Że.
Selon Olivier Louis, les r´┐Żsultats du Conseil europ´┐Żen sont ´┐Żtonnants´┐Ż: l’am´┐Żlioration du syst´┐Żme politique europ´┐Żen est r´┐Żelle´┐Ż; la personnalit´┐Ż juridique de l’Union r´┐Żpond ´┐Ż une conception f´┐Żd´┐Żrale´┐Ż; le trait´┐Ż est juridiquement achev´┐Ż mais une opposition existe, celle de la Pologne´┐Ż:
- en juin 2007, la Pologne ´┐Żmet des demandes qui ne sont pas si extravagantes que´┐Ż cela´┐Ż: elle obtient la prolongation du syst´┐Żme de Nice pour 10 ans.
- en outre, elle invoque le m´┐Żcanisme de Ioannina pour obtenir quelques ann´┐Żes de plus´┐Ż: ce proc´┐Żd´┐Ż, appliqu´┐Ż une fois, ´┐Żvite d’avoir recours ´┐Ż la majorit´┐Ż qualifi´┐Że dans les votes du Conseil en lui substituant une minorit´┐Ż de blocage plus forte qu’´┐Ż l’habitude.
En r´┐Żponse ´┐Ż Philippe Moreau Defarges qui d´┐Żcrit un syst´┐Żme qui serait ´┐Ż bout de souffle, Olivier Louis constate qu’en 12 ans on est pass´┐Ż de 12 ´┐Ż 27 membres.
Donc, le syst´┐Żme a chang´┐Ż d’´┐Żchelle. On se situe d´┐Żsormais dans un syst´┐Żme tr´┐Żs diversifi´┐Ż, bien qu’il faille repenser les trait´┐Żs europ´┐Żens qui lient les 27. Il souligne enfin que d´┐Żj´┐Ż en 1962, le plan Fouchet pr´┐Żvoyait une personnalit´┐Ż juridique de la Commission, donc un ´┐Żl´┐Żment de supranationalit´┐Ż, accept´┐Ż par Charles de Gaulle.
Puis Dani´┐Żla Schwarzer essaye d’´┐Żvaluer ce qu’a apport´┐Ż la pr´┐Żsidence allemande en ´┐Żtablissant un bref bilan.
Tout d’abord, la pr´┐Żsidence allemande avait effectivement pour objectif initial la volont´┐Ż de r´┐Żanimer le Trait´┐Ż Constitutionnel. En r´┐Żalit´┐Ż ceci fut mal consid´┐Żr´┐Ż par la majorit´┐Ż des 27, alors que pourtant 18 Etats avaient approuv´┐Ż le Trait´┐Ż Constitutionnel. D´┐Żs lors, le but de la Pr´┐Żsidence allemande fut de´┐Żsauver le contenu positif du Trait´┐Ż Constitutionnel. A l’issue de la d´┐Żclaration de Berlin, la pr´┐Żsidence allemande s’est employ´┐Że ´┐Ż n´┐Żgocier un mandat pour la C.I.G., celle-ci devant ´┐Żtre uniquement investie d’un travail juridique. L’´┐Żtape suivante, ´┐Ż partir du 20 octobre 2007 devrait ´┐Żtre le processus de ratification par les 27 en 18 mois (avant les ´┐Żlections de 2009).
Selon Dani´┐Żla Schwarzer, la pr´┐Żsidence allemande fut un succ´┐Żs incontestable. L’Europe fonctionne ´┐Ż nouveau, en d´┐Żpit de la tr´┐Żs grosse peur li´┐Że ´┐Ż l’approbation r´┐Żf´┐Żrendaire des Etats et du besoin d’exclure tout d´┐Żbat parlementaire. De plus elle estime que, dans le syst´┐Żme europ´┐Żen, la Commission joue encore un r´┐Żle moteur.
´┐Ż
REPONSES AUX PRINCIPALES QUESTIONS DES AUDITEUR
Selon Philippe Moreau Defarges, l’U.E. a un probl´┐Żme d´┐Żmocratique, parce que les peuples ne suivent´┐Ż pas. En effet la Commission n’a plus d’avenir, car c’est un organisme bizzare qui comporte ´┐Ż la fois un morceau de gouvernement et une autorit´┐Ż de r´┐Żgulation; de la sorte, il y a un m´┐Żlange de supra-national et d’intergouvernemental.. En cons´┐Żquence, il y a, dans la pratique, une modification de l’´┐Żquilibre institutionnel. Philippe Moreau Defarges consid´┐Żre qu’apr´┐Żs le ´┐Ż´┐Żprincipat´┐Ż´┐Ż de Jacques Delors, la commission est en ´┐Ż´┐Żroue libre´┐Ż´┐Ż.
En effet ´┐Ż l’origine, la Commission est un syst´┐Żme o´┐Ż le Pr´┐Żsident est un ´┐Ż´┐Żprimus inter pares´┐Ż´┐Ż. Or, depuis 1995, le pouvoir politique est all´┐Ż progressivement au Conseil europ´┐Żen et a ´┐Żgalement b´┐Żn´┐Żfici´┐Ż au Parlement Europ´┐Żen; en 2007, le Parlement d´┐Żtient beaucoup de pouvoirs, notamment par le jeu de la cod´┐Żcision.
Et Philippe Moreau Defarges consid´┐Żre enfin que l’existence et le r´┐Żsultat de la Convention constituent un ´┐Żchec´┐Ż du processus europ´┐Żen.
Dans ce cadre, il y a eu une l´┐Żgitimation conf´┐Żr´┐Że ´┐Ż trois acteurs´┐Ż: les Parlements et les Gouvernements nationaux ainsi que le Parlement europ´┐Żen.
En revanche, lors de la Convention, la supranationalit´┐Ż de la bonne humeur, incarn´┐Że par Giscard, a ´┐Żchou´┐Ż.
Olivier Louis, centre ses r´┐Żponses sur deux points´┐Ż:
1/ La gestion politique la zone euro´┐Ż:
- Celle-ci est possible ´┐Ż condition d’une harmonisation plus forte de la politique ´┐Żconomique europ´┐Żenne, c’est-´┐Ż-dire une harmonisation des politiques budg´┐Żtaires et fiscales, ce qui est ´┐Żvidemment tr´┐Żs difficile ´┐Ż mettre en place actuellement.
2/ Trois ´┐Żvolutions possibles de l’Europe´┐Ż:
- Renforcement des institutions centrales´┐Ż: l’U.E. devient supra-nationale.
- Affaiblissement des institutions centrales´┐Ż: l’Europe devient intergouvernementale.
- Mod´┐Żle de diff´┐Żrenciation´┐Ż: un groupe d’Etats membres d´┐Żcident d’avancer plus vite ; avant-garde par le truchement des coop´┐Żrations renforc´┐Żes.
Aux yeux de Philippe Moreau Defarges, l’Europe ne pourrait avoir de l’avenir que si l’on conciliait la vision fran´┐Żaise et la vision britannique en construisant les Etats-Unis d’Europe.
´┐Ż
Jean-Fran´┐Żois DURANTIN
Politologue