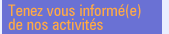Europe´┐Ż: un Trait´┐Ż pour quoi faire´┐Ż?
L’accord conclu aux petites heures du 19 octobre 2007 constitue un modeste compromis. Il est vrai que, depuis Jean Monnet et Robert Schuman, l’Europe avance ´┐Ż petits pas. Avec ce futur trait´┐Ż de Lisbonne qui sera sign´┐Ż le 13 d´┐Żcembre prochain, l’Europe aura les moyens de fonctionner gr´┐Żce ´┐Ż des institutions mieux adapt´┐Żes, la fin du droit de veto ne prenant toutefois effet qu’en 2017. Mais, les Europ´┐Żens qui veulent mieux vivre vont-ils s’´┐Żprendre du ´┐Ż´┐Żvote ´┐Ż la majorit´┐Ż qualifi´┐Że´┐Ż´┐Ż´┐Ż?
On distinguera les changements apport´┐Żs au trait´┐Ż constitutionnel, les difficult´┐Żs de la ratification, les objectifs du trait´┐Ż.
Les changements d’un trait´┐Ż ´┐Ż l’autre sont de quatre ordres´┐Ż: la forme, les modifications, les ´┐Żl´┐Żments conserv´┐Żs, les reculs.
La forme nouvelle du trait´┐Ż consacre la fin du constitutionnalisme europ´┐Żen qui incluait les politiques communes (mon´┐Żtaire, agricole, concurrence, aides aux r´┐Żgions). Dor´┐Żnavant, les politiques communes pourront ´┐Żtre chang´┐Żes aussi facilement que par le pass´┐Ż. Quant aux 27 ´┐Żtats de l’Union, ils ont amend´┐Ż les trait´┐Żs ant´┐Żrieurs en reprenant les modifications institutionnelles du trait´┐Ż mort-n´┐Ż en 2005.
L’embl´┐Żme de la campagne du non en France, ´┐Ż´┐Żla concurrence libre et non fauss´┐Że´┐Ż´┐Ż, initi´┐Że en 2004 par Mario Monti, est supprim´┐Ż des objectifs de l’Union, m´┐Żme s’il est repris dans un protocole annex´┐Ż au trait´┐Ż.
A la demande des Pays-Bas, la protection et le mode de financement des services publics sont r´┐Żaffirm´┐Żs, bien qu’ils figurent en annexe.
Les ´┐Żl´┐Żments conserv´┐Żs sont plus nombreux, mais leur application est repouss´┐Że dans le temps. En r´┐Żalit´┐Ż, la substance du Trait´┐Ż (Partie I) est sauvegard´┐Że, dans la mesure o´┐Ż la r´┐Żforme institutionnelle de 2004 est pr´┐Żserv´┐Że.
´┐ŻA partir de janvier 2009, le Pr´┐Żsident du Conseil Europ´┐Żen sera ´┐Żlu pour 2,5 ans. Quant au vote ´┐Ż la majorit´┐Ż qualifi´┐Że, il verra son extension ´┐Ż 41 domaines, alors que le contr´┐Żle du Parlement Europ´┐Żen sera ´┐Żtendu ´┐Ż autant de questions.
´┐Ż A compter de 2014, la taille de la Commission sera r´┐Żduite, r´┐Żaffirmant par l´┐Ż son caract´┐Żre supranational. A la suite des revendications polonaises, la majorit´┐Ż qualifi´┐Że au sein du Conseil ne sera plus facile ´┐Ż r´┐Żunir qu’´┐Ż partir d’avril 2017 (55% des ´┐Żtats repr´┐Żsentant 65% de la population)´┐Ż; ult´┐Żrieurement, on pourra recourir au compromis de Ioannina´┐Ż: il s’agit de la substitution ´┐Ż la majorit´┐Ż qualifi´┐Że d’une minorit´┐Ż de blocage par 4 ´┐Żtats´┐Ż; alors on pourra geler´┐Ż une d´┐Żcision pendant ´┐Ż´┐Żun d´┐Żlai raisonnable´┐Ż´┐Ż.
Selon Nicolas Sarkozy, ces mesures correspondent au ´┐Ż´┐Żconsensus de toutes les forces politiques´┐Ż´┐Ż. Ce jugement est bien optimiste ´┐Ż l’endroit des forces politiques des ´┐Żtats demeur´┐Żs eurosceptiques.
Les reculs concernent le poste de Ministre des Affaires ´┐Żtrang´┐Żres, la Charte des droits fondamentaux, les autres clauses d’opting out du Royaume Uni.
A la demande de celui-ci, on remplace le Ministre des Affaires Ext´┐Żrieures par un Haut Repr´┐Żsentant charg´┐Ż de la Politique ´┐Żtrang´┐Żre et de la S´┐Żcurit´┐Ż: ainsi l’attribut d’un super ´┐Żtat europ´┐Żen est-il supprim´┐Ż.
Quant ´┐Ż la Charte des droits fondamentaux, elle reste un texte en dehors du trait´┐Ż dont les dispositions ne s’appliquent ni au Royaume Uni, ni ´┐Ż la Pologne.
Le Royaume Uni b´┐Żn´┐Żficie de nombreuses clauses d’opting out, notamment en mati´┐Żre d’immigration ainsi que de coop´┐Żration polici´┐Żre et judiciaire´┐Ż; celles-ci consacrent une int´┐Żgration diff´┐Żrenci´┐Że plus approfondie.
En cons´┐Żquence, si la substance institutionnelle est conserv´┐Że, les exceptions inscrites dans le trait´┐Ż donnent naissance ´┐Ż un syst´┐Żme tr´┐Żs diversifi´┐Ż au point qu’il faudra probablement revoir un jour l’ensemble des trait´┐Żs qui lient les 27.
Les difficult´┐Żs de la ratification n’ont pas ´┐Żt´┐Ż ´┐Żvoqu´┐Żes ´┐Ż Lisbonne et pourtant elles sont consid´┐Żrables.
Tout d’abord, le processus de ratification s’´┐Żtendra sur moins de 13 mois au lieu des 18 mois habituels.
Ensuite, s’il est vrai que seule l’Irlande est juridiquement astreinte ´┐Ż un r´┐Żf´┐Żrendum, la voie parlementaire est emplie d’emb´┐Żches.
En France, tout d’abord, la majorit´┐Ż des 3/5 des suffrages exprim´┐Żs au Congr´┐Żs est loin d’´┐Żtre atteinte et il faudra au Pr´┐Żsident Sarkozy des tr´┐Żsors d’habilet´┐Ż pour obtenir le vote positif d’une quarantaine de parlementaires socialistes, ´┐Ż moins que tous ne s’abstiennent.
D’autre part, on ne sait pas si Gordon Brown, au Royaume Uni, ne sera pas contraint de proc´┐Żder ´┐Ż un r´┐Żf´┐Żrendum tant est puissante la force des tablo´┐Żds.
Quant ´┐Ż l’euroscepticisme des classes politiques tch´┐Żque et polonaise, on ne peut pas dire que la voie parlementaire soit la voie royale.
Il peut ´┐Żgalement arriver que la conjonction des d´┐Żbats dans les journaux et dans chaque Parlement aboutisse ´┐Ż constituer un exutoire pour r´┐Żgler des probl´┐Żmes de politique int´┐Żrieure, voire des diff´┐Żrends entre les ´┐Żlus du peuple et le pouvoir gouvernemental.
De la sorte, la ratification par l’ensemble des ´┐Żtats de l’Union Europ´┐Żenne est plus que p´┐Żrilleuse´┐Ż: on peut envisager un vote n´┐Żgatif du Royaume Uni et ´┐Żgalement le refus de ratifier de 2 ´┐Ż 3 petits ´┐Żtats.
Or, si gouverner c’est pr´┐Żvoir, la pr´┐Żsidence portugaise a omis d’envisager le pire. En effet, une clause d’approbation du trait´┐Ż par seulement 4/5 des ´┐Żtats qui vaudrait ratification globale, ´┐Ż la suite d’une r´┐Żunion du Conseil Europ´┐Żen qui serait amen´┐Ż ´┐Ż la concr´┐Żtiser, n’a pas ´┐Żt´┐Ż prise en amont. Il s’agit l´┐Ż d’une grande impr´┐Żvoyance.
´┐Ż
Si l’on consid´┐Żre les objectifs initiaux du trait´┐Ż, d´┐Żfinis dans la d´┐Żclaration de La´┐Żken, le 15 d´┐Żcembre 2001, on doit s’interroger sur l’utilit´┐Ż du Trait´┐Ż de Lisbonne, alors m´┐Żme que le trait´┐Ż de Nice de d´┐Żcembre 2000, -qui r´┐Żgit les conditions actuelles de la majorit´┐Ż au Conseil des Ministres,-n’a pas donn´┐Ż de r´┐Żsultats satisfaisants.
On conviendra que le trait´┐Ż qui vient d’´┐Żtre adopt´┐Ż ´┐Ż Lisbonne sort l’Union de l‘impasse institutionnelle qui existait depuis 7 ans.
Mais le v´┐Żritable projet de l’Union, propos´┐Ż ´┐Żgalement en 2000, ´┐Ż´┐Żl’agenda de Lisbonne´┐Ż´┐Ż, qui souhaitait faire de l’Europe ´┐Ż´┐Żl’´┐Żconomie de la connaissance la plus comp´┐Żtitive et la plus dynamique d’ici 2010´┐Ż´┐Ż, demeure encore dans les limbes.
Quand l’Allemagne renonce aux r´┐Żformes et que la France s’engage de fa´┐Żon chaotique sur la voie des r´┐Żformes structurelles, on peut se demander comment faire pour renforcer l’innovation et la comp´┐Żtitivit´┐Ż dans l’Union tout enti´┐Żre.
D´┐Żs lors que les 13 ´┐Żtats qui ont adopt´┐Ż l’€uro se montrent incapables de coordonner leurs politiques budg´┐Żtaire et fiscale, que reste-t-il ´┐Ż faire´┐Ż?
Tandis que les Allemands persistent dans la voie d’une Europe ultra-lib´┐Żrale et mondialis´┐Że, alors, que la France souhaite une protection des citoyens ´┐Ż l’ext´┐Żrieur et veut favoriser ses champions nationaux industriels ´┐Ż l’int´┐Żrieur, le Pr´┐Żsident de la Commission ne peut rester inerte et doit indiquer la voie ´┐Ż suivre.
La France et l’Allemagne ne constituant plus les ´┐Żl´┐Żves mod´┐Żles de l’Union, il convient que la Commission mette chacun devant ses responsabilit´┐Żs et se dote d’une imagination cr´┐Żatrice pour relancer la dynamique europ´┐Żenne.
Ainsi, la relance institutionnelle de l’Union Europ´┐Żenne constitue-t-elle une condition pr´┐Żalable n´┐Żcessaire mais insuffisante du redressement ´┐Żconomique des 27.
Pour rapprocher l’Europe des citoyens, il faut que chaque ´┐Żtat respecte les normes impos´┐Żes par Bruxelles et que la Commission d´┐Żfinisse les grands objectifs d’une Europe qui lib´┐Żrerait des forces nouvelles pour la cr´┐Żation, la comp´┐Żtitivit´┐Ż, la capacit´┐Ż d’innovation.
´┐Ż
Jean-Fran´┐Żois DURANTIN
Politologue